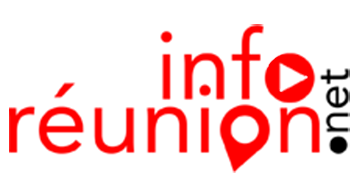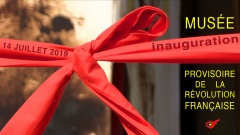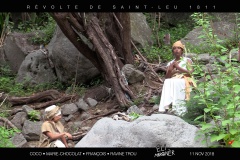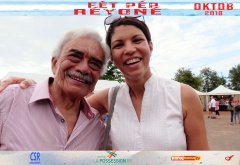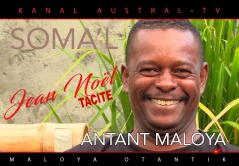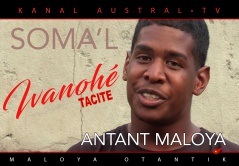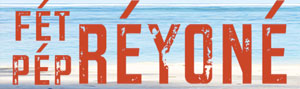Pour Mgr Ricard, la juste revendication pour les personnes homosexuelles d'échapper aux diverses formes de réprobation encore présentes dans notre société doit être entendue. Cependant, l'intérêt affectif et éducatif de l'enfant (expérience de la différenciation sexuelle au sein même de la cellule familiale, droit à connaître a priori sa filiation biologique), ainsi que la complémentarité fondamentale du masculin et du féminin dans toutes sociétés ne peuvent être passés sous silence.
Si le mariage ne peut être "pour tous", sa défense est l'affaire de chacun.
A propos du prochain projet de loi ouvrant la possibilité du mariage aux personnes de même sexe.
Le gouvernement a commencé à dévoiler le futur projet de loi concernant « le mariage pour tous ». Ce projet se veut d’ambition modeste : il ne s’agirait que d’élargir la possibilité de se marier et d’adopter des enfants à une catégorie de personnes, qui, aujourd’hui, en sont privées, à savoir deux personnes du même sexe. En fait, cette loi, si elle était votée, remettrait en question, en la bouleversant radicalement, l’institution du mariage et de la filiation.
Ce qui est en jeu
Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme, visant à fonder une famille et à y accueillir des enfants. Il n’est pas cette reconnaissance publique des sentiments, à laquelle pourraient aspirer tous ceux qui s’aiment sincèrement. Cette reconnaissance ne regarde pas les pouvoirs publics. Par contre, ceux-ci sont concernés par la fonction sociale qu’a le mariage : il insère le couple dans la société et inscrit la filiation dans une institution stable. Le couple marié contribue à l’édification de la société en transmettant la vie et en participant à un véritable travail éducatif. Les droits liés au mariage viennent en contrepartie des missions, tâches et devoirs des époux et parents.
Toutes les sociétés ont fondé l’institution du mariage sur la différence des sexes. Il n’y a pas là quelque chose d’archaïque ou de dépassé, mais une juste perception de ce qu’est la vraie nature du couple humain. La révélation biblique vient d’ailleurs nous confirmer que cette donnée, présente au cœur de sociétés et de cultures extrêmement diverses, s’inscrit en fait dans le dessein même de Dieu : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa ; homme et femme il les créa » (Gn 1, 27).
Un enfant a droit à avoir un père et une mère. Ce n’est pas parce que la loi a autorisé des célibataires à pouvoir adopter qu’il faut remettre en question ce droit fondamental de l’enfant. Ce que le droit doit protéger ce n’est pas d’abord le désir des parents mais le besoin des enfants. Certes, des enfants peuvent se retrouver aujourd’hui dans des situations où ils n’ont pas auprès d’eux un père et une mère. Mais, c’est tout autre chose que d’organiser a priori une situation où des enfants ne pourront ni se réclamer d’une filiation claire, ni faire l’expérience de la différence sexuée.
L’adoption par deux personnes du même sexe ne peut que troubler la filiation et la conscience qu’un enfant peut en avoir. Il est significatif d’ailleurs de constater que certains préfèrent au terme de « parenté » celui de « parentalité ».
Sur des fiches d’état civil, on risquera bientôt, comme en Espagne, de ne plus parler de « père » et de « mère » mais de « parent 1 » et de « parent 2 » ! Faudra-t-il aussi ajouter un « parent 3 » pour indiquer quelle est l’origine complète d’un enfant ?
Derrière cette conception de l’homoparentalité, émerge une logique de « dissociation » tout à fait préjudiciable à l’intérêt de l’enfant : entre parenté et parentalité, sexualité et filiation, couple et procréation, procréation et filiation. Inutile de dire que cette loi, si elle était votée, bouleverserait profondément notre système juridique concernant la filiation.
Il semble bien que les promoteurs de notre loi n’en aient pas mesuré toutes les conséquences. « Depuis toujours nous descendons tous d’un homme et d’une femme : cette loi est fondatrice de notre condition humaine.
Le droit s’appuie sur cette réalité objective pour organiser le lien social » (Ph. MALAURIE, Aspects juridiques, le pacte civil de solidarité, dans Documents épiscopat Sept. 1998, p.4). Aussi est-il de la plus haute nécessité de ne pas brouiller le sens du droit et de ne pas réduire la force d’un tel repère à la source de notre vivre ensemble.
Pourquoi en est-on arrivé là ?
Cette loi est souhaitée par un certain nombre d’associations de personnes homosexuelles. Le phénomène de « lobbying », qu’elles exercent par pression sur les politiques et par orchestration médiatique des grands thèmes qui leur sont chers, est puissant.
Ceci dit, il faut constater que la revendication d’un « mariage pour tous » n’est pas une revendication de toutes les personnes homosexuelles, loin de là. On peut être étonné que le pouvoir politique préfère donner satisfaction à des revendications catégorielles de groupes particuliers plutôt que d’envisager le bien commun de toute une société. Il y a là, sur ce point comme sur d’autres d’ailleurs, un fonctionnement du politique qui n’est pas sans poser problème.
Ce projet de loi se veut une mesure visant à promouvoir l’égalité et la non-discrimination envers les personnes homosexuelles. La philosophie sous-jacente de ceux qui défendent cette position est de parler de l’égalité des « orientations sexuelles ». Un certain nombre font référence à la théorie du « gender », du « genre », qui nous vient des Etats-Unis.
Ils affirment que le fait d’être homme ou d’être femme est un produit culturel, soumis à bien des fluctuations liées à l’histoire des personnes et des sociétés. C’est la subjectivité de chacun qui lui fait découvrir quelle est son orientation sexuelle.
La différence sexuelle est donc une donnée contingente qui ne saurait être invoquée comme le fondement permanent du mariage. Cette façon de voir est gravement problématique. Même s’il faut reconnaître que notre éducation, notre culture et notre histoire façonnent notre identité sexuelle, celle-ci ne se réduit pas à une donnée purement culturelle.
La différence sexuelle fait partie de ce « réel », dont parlent les psychanalystes, qui intègre le biologique et le dépasse tout à la fois. La différence est constitutive de la personne. Elle participe à son identité profonde : « Créés ensemble, l’homme et la femme sont voulus par Dieu l’un pour l’autre…créés pour une communion de personne, en laquelle chacun peut être ‘aide’ pour l’autre parce qu’ils sont à la fois égaux en tant que personnes….et complémentaires en tant que masculin et féminin » (Catéchisme de l’Eglise catholique, n° 371-372).
Dire aux personnes homosexuelles que le mariage est une institution qui n’est pas faite pour elles, n’est ni une marque de discrimination ni un signe d’homophobie, comme il n’est pas discriminant envers les personnes de rappeler qu’il ne saurait y avoir de mariage entre frère et sœur ou entre majeur et mineur…
En ce sens là, l’expression « mariage pour tous » est erronée : le mariage n’est pas ouvert à toutes les situations affectives. L’égalité ne gomme pas les différences et ce sont justement ces différences qui appellent des traitements différents.
Certes, on peut entendre ce désir de beaucoup de personnes homosexuelles d’échapper à des formes de réprobation de leur état encore présentes dans notre société. Il y a encore bien à faire pour qu’elles se sentent accueillies et respectées (cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, n° 2358). Mais, en demandant l’accès au mariage, ne se trompent-elles pas de lieu du combat ?
Que peut-on faire ?
Devant ce projet de loi, nous sommes, en fait, devant un vrai choix de société, vu ses conséquences. Un gouvernement ne peut donc pas le traiter rapidement et le faire voter à la hussarde. Il est souhaitable, pour la santé de notre démocratie, qu’un vaste débat soit proposé et organisé. Les évêques de France, par la voix de leur président, l’ont demandé et continuent à le demander aujourd’hui.
Les catholiques peuvent également écrire à leurs élus (députés, sénateurs, maires, conseillers régionaux et généraux) pour leur faire part de leurs opinions et de leur volonté. C’est de notre devoir de citoyen d’exprimer notre réflexion et nos suggestions.
D’autres initiatives seront sans doute proposées dans les semaines qui viennent. Chacun, comme citoyen, jugera les moyens qui lui paraîtront les plus judicieux pour manifester publiquement son opinion. Rappelons simplement qu’il est important, dans cet engagement, d’exprimer qu’il ne s’agit pas de défendre une position qui pourrait apparaître comme étroitement confessionnelle.
Cette défense du mariage, comme union d’un homme et d’une femme, touche d’abord une question fondamentale de notre société et peut ainsi être soutenue par des français de différentes confessions, religions ou convictions philosophiques, sans parler d’un certain nombre de maires qui ont fait savoir leur opposition à la célébration de mariages entre personnes de même sexe. Si le mariage ne peut être pour tous, sa défense est l’affaire de chacun !
Source
Archevêque de Bordeaux
Évêque de Bazas
A propos du prochain projet de loi ouvrant la possibilité du mariage aux personnes de même sexe.
Le gouvernement a commencé à dévoiler le futur projet de loi concernant « le mariage pour tous ». Ce projet se veut d’ambition modeste : il ne s’agirait que d’élargir la possibilité de se marier et d’adopter des enfants à une catégorie de personnes, qui, aujourd’hui, en sont privées, à savoir deux personnes du même sexe. En fait, cette loi, si elle était votée, remettrait en question, en la bouleversant radicalement, l’institution du mariage et de la filiation.
Ce qui est en jeu
Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme, visant à fonder une famille et à y accueillir des enfants. Il n’est pas cette reconnaissance publique des sentiments, à laquelle pourraient aspirer tous ceux qui s’aiment sincèrement. Cette reconnaissance ne regarde pas les pouvoirs publics. Par contre, ceux-ci sont concernés par la fonction sociale qu’a le mariage : il insère le couple dans la société et inscrit la filiation dans une institution stable. Le couple marié contribue à l’édification de la société en transmettant la vie et en participant à un véritable travail éducatif. Les droits liés au mariage viennent en contrepartie des missions, tâches et devoirs des époux et parents.
Toutes les sociétés ont fondé l’institution du mariage sur la différence des sexes. Il n’y a pas là quelque chose d’archaïque ou de dépassé, mais une juste perception de ce qu’est la vraie nature du couple humain. La révélation biblique vient d’ailleurs nous confirmer que cette donnée, présente au cœur de sociétés et de cultures extrêmement diverses, s’inscrit en fait dans le dessein même de Dieu : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa ; homme et femme il les créa » (Gn 1, 27).
Un enfant a droit à avoir un père et une mère. Ce n’est pas parce que la loi a autorisé des célibataires à pouvoir adopter qu’il faut remettre en question ce droit fondamental de l’enfant. Ce que le droit doit protéger ce n’est pas d’abord le désir des parents mais le besoin des enfants. Certes, des enfants peuvent se retrouver aujourd’hui dans des situations où ils n’ont pas auprès d’eux un père et une mère. Mais, c’est tout autre chose que d’organiser a priori une situation où des enfants ne pourront ni se réclamer d’une filiation claire, ni faire l’expérience de la différence sexuée.
L’adoption par deux personnes du même sexe ne peut que troubler la filiation et la conscience qu’un enfant peut en avoir. Il est significatif d’ailleurs de constater que certains préfèrent au terme de « parenté » celui de « parentalité ».
Sur des fiches d’état civil, on risquera bientôt, comme en Espagne, de ne plus parler de « père » et de « mère » mais de « parent 1 » et de « parent 2 » ! Faudra-t-il aussi ajouter un « parent 3 » pour indiquer quelle est l’origine complète d’un enfant ?
Derrière cette conception de l’homoparentalité, émerge une logique de « dissociation » tout à fait préjudiciable à l’intérêt de l’enfant : entre parenté et parentalité, sexualité et filiation, couple et procréation, procréation et filiation. Inutile de dire que cette loi, si elle était votée, bouleverserait profondément notre système juridique concernant la filiation.
Il semble bien que les promoteurs de notre loi n’en aient pas mesuré toutes les conséquences. « Depuis toujours nous descendons tous d’un homme et d’une femme : cette loi est fondatrice de notre condition humaine.
Le droit s’appuie sur cette réalité objective pour organiser le lien social » (Ph. MALAURIE, Aspects juridiques, le pacte civil de solidarité, dans Documents épiscopat Sept. 1998, p.4). Aussi est-il de la plus haute nécessité de ne pas brouiller le sens du droit et de ne pas réduire la force d’un tel repère à la source de notre vivre ensemble.
Pourquoi en est-on arrivé là ?
Cette loi est souhaitée par un certain nombre d’associations de personnes homosexuelles. Le phénomène de « lobbying », qu’elles exercent par pression sur les politiques et par orchestration médiatique des grands thèmes qui leur sont chers, est puissant.
Ceci dit, il faut constater que la revendication d’un « mariage pour tous » n’est pas une revendication de toutes les personnes homosexuelles, loin de là. On peut être étonné que le pouvoir politique préfère donner satisfaction à des revendications catégorielles de groupes particuliers plutôt que d’envisager le bien commun de toute une société. Il y a là, sur ce point comme sur d’autres d’ailleurs, un fonctionnement du politique qui n’est pas sans poser problème.
Ce projet de loi se veut une mesure visant à promouvoir l’égalité et la non-discrimination envers les personnes homosexuelles. La philosophie sous-jacente de ceux qui défendent cette position est de parler de l’égalité des « orientations sexuelles ». Un certain nombre font référence à la théorie du « gender », du « genre », qui nous vient des Etats-Unis.
Ils affirment que le fait d’être homme ou d’être femme est un produit culturel, soumis à bien des fluctuations liées à l’histoire des personnes et des sociétés. C’est la subjectivité de chacun qui lui fait découvrir quelle est son orientation sexuelle.
La différence sexuelle est donc une donnée contingente qui ne saurait être invoquée comme le fondement permanent du mariage. Cette façon de voir est gravement problématique. Même s’il faut reconnaître que notre éducation, notre culture et notre histoire façonnent notre identité sexuelle, celle-ci ne se réduit pas à une donnée purement culturelle.
La différence sexuelle fait partie de ce « réel », dont parlent les psychanalystes, qui intègre le biologique et le dépasse tout à la fois. La différence est constitutive de la personne. Elle participe à son identité profonde : « Créés ensemble, l’homme et la femme sont voulus par Dieu l’un pour l’autre…créés pour une communion de personne, en laquelle chacun peut être ‘aide’ pour l’autre parce qu’ils sont à la fois égaux en tant que personnes….et complémentaires en tant que masculin et féminin » (Catéchisme de l’Eglise catholique, n° 371-372).
Dire aux personnes homosexuelles que le mariage est une institution qui n’est pas faite pour elles, n’est ni une marque de discrimination ni un signe d’homophobie, comme il n’est pas discriminant envers les personnes de rappeler qu’il ne saurait y avoir de mariage entre frère et sœur ou entre majeur et mineur…
En ce sens là, l’expression « mariage pour tous » est erronée : le mariage n’est pas ouvert à toutes les situations affectives. L’égalité ne gomme pas les différences et ce sont justement ces différences qui appellent des traitements différents.
Certes, on peut entendre ce désir de beaucoup de personnes homosexuelles d’échapper à des formes de réprobation de leur état encore présentes dans notre société. Il y a encore bien à faire pour qu’elles se sentent accueillies et respectées (cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, n° 2358). Mais, en demandant l’accès au mariage, ne se trompent-elles pas de lieu du combat ?
Que peut-on faire ?
Devant ce projet de loi, nous sommes, en fait, devant un vrai choix de société, vu ses conséquences. Un gouvernement ne peut donc pas le traiter rapidement et le faire voter à la hussarde. Il est souhaitable, pour la santé de notre démocratie, qu’un vaste débat soit proposé et organisé. Les évêques de France, par la voix de leur président, l’ont demandé et continuent à le demander aujourd’hui.
Les catholiques peuvent également écrire à leurs élus (députés, sénateurs, maires, conseillers régionaux et généraux) pour leur faire part de leurs opinions et de leur volonté. C’est de notre devoir de citoyen d’exprimer notre réflexion et nos suggestions.
D’autres initiatives seront sans doute proposées dans les semaines qui viennent. Chacun, comme citoyen, jugera les moyens qui lui paraîtront les plus judicieux pour manifester publiquement son opinion. Rappelons simplement qu’il est important, dans cet engagement, d’exprimer qu’il ne s’agit pas de défendre une position qui pourrait apparaître comme étroitement confessionnelle.
Cette défense du mariage, comme union d’un homme et d’une femme, touche d’abord une question fondamentale de notre société et peut ainsi être soutenue par des français de différentes confessions, religions ou convictions philosophiques, sans parler d’un certain nombre de maires qui ont fait savoir leur opposition à la célébration de mariages entre personnes de même sexe. Si le mariage ne peut être pour tous, sa défense est l’affaire de chacun !
Source
Archevêque de Bordeaux
Évêque de Bazas