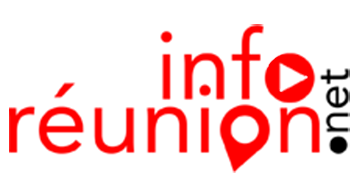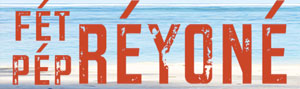1. Héritage colonial et premières fidélités (XVIIᵉ–XIXᵉ siècles)
La colonisation par la France débute en 1642, l'île est d'abord nommée île Bourbon, puis rebaptisée Réunion en 1793. Pourtant, l’identité nationale reste limitée : les premiers habitants – esclaves africains, engagés malgaches, indiens, colons européens – ne construisent initialement aucun sentiment d’appartenance à une France lointaine.
Ce n’est qu’au fil des générations, avec un métissage culturel et linguistique, que la construction identitaire commence à s’affiner.
Ce n’est qu’au fil des générations, avec un métissage culturel et linguistique, que la construction identitaire commence à s’affiner.
2. L’école, l’église, l’armée
Les vecteurs d’acculturation (fin XIXᵉ–1946)
Au tournant du XXᵉ siècle, l’école française, l'église catholique et l’engagement dans la Grande Guerre offrent des premières occasions de se sentir “Français”. Une recherche souligne que ces institutions participent largement à forger un sentiment national dès l’époque coloniale.
Au tournant du XXᵉ siècle, l’école française, l'église catholique et l’engagement dans la Grande Guerre offrent des premières occasions de se sentir “Français”. Une recherche souligne que ces institutions participent largement à forger un sentiment national dès l’époque coloniale.
3. Départementalisation de 1946
Une citoyenneté pleine, mais une appartenance ambivalente
Le 16 mars 1946, La Réunion devient département français : les Réunionnais acquièrent les mêmes droits politiques et sociaux qu’en métropole. Juridiquement, ils sont Français, mais le sentiment de l’être reste nuancé, empreint d’un attachement au local et de revendications identitaires.
Le 16 mars 1946, La Réunion devient département français : les Réunionnais acquièrent les mêmes droits politiques et sociaux qu’en métropole. Juridiquement, ils sont Français, mais le sentiment de l’être reste nuancé, empreint d’un attachement au local et de revendications identitaires.
4. Une appartenance constante… mais contrastée
Selon plusieurs études, le sentiment d’appartenance nationale est resté constant, même durant l’époque coloniale ; il est pourtant toujours teinté par la conscience d’une spécificité réunionnaise, forgée par l’histoire plurielle et le poids de la départementalisation. Les élites, l’école, l'église et l’armée ont joué un rôle moteur dans cette construction identitaire.
5. Réaffirmation créole, diglossie et ambivalences contemporaines
Aujourd’hui, de nombreux Réunionnais naviguent entre deux registres : le français (langue officielle, institutionnelle) et le créole (langue maternelle, icône identitaire). Des mouvements culturels – poésie du « fonnkèr », revendications politiques locale – réaffirment une appartenance réunionnaise tout en demeurant compatibles avec un sentiment de nation française.
en conclusion
Le lien juridique à la France a été établi dès 1946 (départementalisation).
Le sentiment d’appartenance s’enracine plus tôt, dès la fin du XIXᵉ siècle, via l’éducation, la religion et la guerre.
Les Réunionnais ressentent une double appartenance : citoyenneté française d’un côté, identité créole/régionale de l’autre.
Le sentiment d’appartenance s’enracine plus tôt, dès la fin du XIXᵉ siècle, via l’éducation, la religion et la guerre.
Les Réunionnais ressentent une double appartenance : citoyenneté française d’un côté, identité créole/régionale de l’autre.