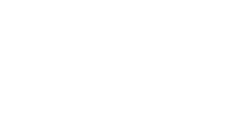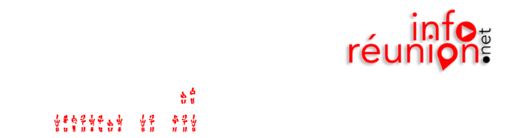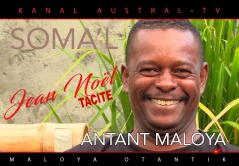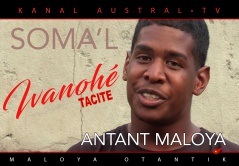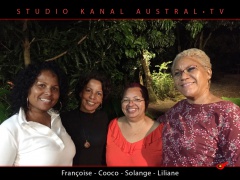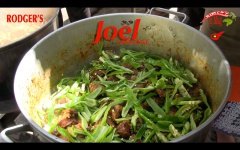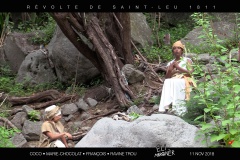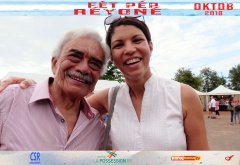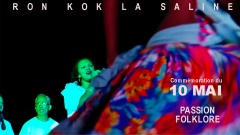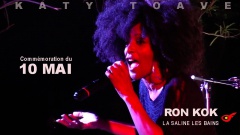"Un quidam gagné par l’émotion -à moins que ce ne soit l’intolérance-, lance à la cantonade, "faites cette cérémonie là-bas, Calcutta". Loin de se laisser distraire par cette remarque désobligeante, le groupe plus concentré que jamais répète lettre après lettre les hymnes sacrés. Chacun pardonne l’intrus aux paroles légères pour son ignorance manifeste de l’histoire de son île. Car l’objectif des organisateurs est de rendre hommage aux « 35 insoumis de l’Ilet à Cabris ».
Ce site est situé à quelques nautiques de Terre de Haut. Le chiffre de 35 est sans doute incorrect. En effet, cet hommage fait suite au travail d’un passionné de généalogie, Michel Rogers. Ce Guadeloupéen est intrigué lorsqu’il découvre aux archives départementales une série anormale de décès d’Indiens à Ilet à Cabris à la fin du 19e siècle. Cette période correspond à l’immigration indienne organisée par la France. Son étonnement provient du fait que les actes de décès portent systématiquement la mention "insoumis".
Ces Indiens décédés, étaient retenus à l’Ilet à Cabris pour « insoumission ». L'insoumission est typiquement un délit punissable dans les organisations hiérarchiques précisent une source partielle, Wikipédia. A travers le vocable "insoumis", l’on peut entendre l’individu homme ou femme, qui ne respecte pas les consignes, ou les ordres ou encore qui entre en rébellion. Le terme est à employer avec prudence. L’humaniste, Père Wrezinsky n’a-t-il pas donné le film « Joseph l’insoumis » ?
Qu’ont fait ces hommes et femmes d’origine indienne pour mériter l’exil ou la mort sur l’Ilet à Cabris, îlot désert, dont on ne pouvait s’échapper qu’au terme de plusieurs jours de navigation ? Michel Rogers a exhumé également un ou deux actes concernant des descendants d’Africains insoumis eux aussi. L’acte d’une immigrée indienne a aussi été mise au jour.
Sous l’engagisme, les motifs les plus futiles conduisaient à l’incarcération. Ainsi un quidam arrêté sans papier était immédiatement conduit à la maison d’arrêt. Cette méthode expéditive, destinée à casser toute velléité de rébellion ou de désordre était en cours également à La Réunion.
Néanmoins des zones d’ombre persistent, interrogeant l’aspect historique et politique de ce dossier. La précipitation n’a rien à voir avec la comparaison. Ainsi Michel Narayaninsamy, président du Gopio Guadeloupe n’a pas hésité à dénoncer une politique coloniale qui cassait de l’Indien à la fin du 19e siècle. Or les seuls éléments authentiques sont des actes de décès, avec la mention de l’insoumission. M. Rogers a-t-il soulevé un dossier supplémentaire qui viendrait confirmer les mauvais traitements infligés aux engagés ? Seul un travail d’historien peut désormais compléter la découverte de l’Ilet à Cabris.
L’expertise de ce travail serait plus que nécessaire, mais également plus éloquent que le silence actuel caractérisant cette affaire. Car l’historien absent prendrait alors le risque de laisser parler à sa place des profanes que souvent l’émotion guide. La tradition orale au « pays » de Césaire (voisin de Guadeloupe), possède peu de version de cette histoire récente. Mais aurait-elle été digne de foi ?
Certaines écoles historiques ne sont pas prêtes à les incorporer dans leur recherche de la vérité. Dans le cas de l’Ilet à Cabris, quelle place accorder à ces témoignages ?
Le maire de Terre de Haut, Louis Molinié, très impliqué dans son rôle d’élu de la République a accepté l’installation d’une stèle sur laquelle figurent les noms des « suppliciés » guadeloupéens. Un habitué des questions de la mémoire des Indiens de la Caraïbe, Francis Ponaman, quant à lui, précise que des Indiens condamnés n’ont jamais été exonérés du célèbre bagne de Cayenne (La Guyane). La municipalité consciente de la nécessité d’un travail pédagogique , élabore un dossier afin d’ établir un site de mémoire sur l’Ilet à Cabri.
En raison des règles de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, cette démarche nécessite de la patience. Elle pourrait être accueillie favorablement dans le cadre de l’année Sidambarom, défenseur fougueux de la cause indienne dans la reconnaissance de leur statut de français et des droits afférents.
L’Ilet à Cabris est-il appelé à devenir un haut-lieu de la mémoire indienne en Guadeloupe ? A l’île Maurice, le dépôt d’immigration des Indiens, appelé Aapravasi Ghât, a été classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, et occupe une place importante dans la mémoire nationale mauricienne.
A La Réunion, l’Ilet Cabri possède son jumeau, l’Ilet à Guillaume. Pascale Moignoux a été l’une des premières plumes à évoquer le sîte4. Juché sur les hauteurs de Saint-Denis le chef-lieu, l’Ilet Guillaume recevait des enfants entre 1864 et 1879, que la société rejetait. Coincés pour des menus larcins ou l’absence de parents, ils étaient internés dans cette "maison de redressement".
Tous ne sont pas revenus de l’Ilet. Quelques uns ont laissé leur vie, accidentellement. Géré par les Jésuites, le site ferma définitivement sur ordre de l’Etat. Dans l’ile, l’Ilet à Guillaume, aujourd’hui abandonné n’est pas resté dans la mémoire collective.
S’agissant de l’attachement à la mémoire de l’engagisme indien, la Région Réunion via le service Patrimoine et l’Association de sauvegarde de la mémoire réunionnaise s’est pleinement engagée en prêtant l’exposition « Coromandel , de l’Inde à la Réunion » à nos amis guadeloupéens.
Qu’il s’agisse de Terre de Haut ou de St François, les communes guadeloupéennes ont bien saisi l’appel lancé par des associations réunionnaises dans le but d’échanger dans le domaine culturel, domaine qui pourrait être amené à s’étendre.
Cette rencontre a représenté une réelle ouverture dans les échanges entre insulaires, une occasion de ne pas céder aux contraintes liées à l’éloignement géographique, sur fond de mémoire aux « Insoumis de l’Ilet à Cabris".
L’ilet aurait abrité les forts Napoléon et Joséphine. Un camp pour isoler les malades existait aussi.
Intellectuel originaire de la Guadeloupe, installé à Paris, qui se bat pour la préservation de la mémoire des engagés Indiens.
SIDAMBAROM Henri, connu à travers son "Procès politique", ouvrage ré-édité à l’occasion de l’anniversaire de sa naissance. Au niveau associatif, l’année Sidambarom 2013, est notamment portée par le petit-fils de celui-ci, Jacques Sidambarom et Jean Samuel Sahai.
MOIGNOUX P. "Graines de bagnard". Roman d’une enfance sacrifiée à l’Ilette à Guillaume. Azalées Editions, 2006
Ce site est situé à quelques nautiques de Terre de Haut. Le chiffre de 35 est sans doute incorrect. En effet, cet hommage fait suite au travail d’un passionné de généalogie, Michel Rogers. Ce Guadeloupéen est intrigué lorsqu’il découvre aux archives départementales une série anormale de décès d’Indiens à Ilet à Cabris à la fin du 19e siècle. Cette période correspond à l’immigration indienne organisée par la France. Son étonnement provient du fait que les actes de décès portent systématiquement la mention "insoumis".
Ces Indiens décédés, étaient retenus à l’Ilet à Cabris pour « insoumission ». L'insoumission est typiquement un délit punissable dans les organisations hiérarchiques précisent une source partielle, Wikipédia. A travers le vocable "insoumis", l’on peut entendre l’individu homme ou femme, qui ne respecte pas les consignes, ou les ordres ou encore qui entre en rébellion. Le terme est à employer avec prudence. L’humaniste, Père Wrezinsky n’a-t-il pas donné le film « Joseph l’insoumis » ?
Qu’ont fait ces hommes et femmes d’origine indienne pour mériter l’exil ou la mort sur l’Ilet à Cabris, îlot désert, dont on ne pouvait s’échapper qu’au terme de plusieurs jours de navigation ? Michel Rogers a exhumé également un ou deux actes concernant des descendants d’Africains insoumis eux aussi. L’acte d’une immigrée indienne a aussi été mise au jour.
Sous l’engagisme, les motifs les plus futiles conduisaient à l’incarcération. Ainsi un quidam arrêté sans papier était immédiatement conduit à la maison d’arrêt. Cette méthode expéditive, destinée à casser toute velléité de rébellion ou de désordre était en cours également à La Réunion.
Néanmoins des zones d’ombre persistent, interrogeant l’aspect historique et politique de ce dossier. La précipitation n’a rien à voir avec la comparaison. Ainsi Michel Narayaninsamy, président du Gopio Guadeloupe n’a pas hésité à dénoncer une politique coloniale qui cassait de l’Indien à la fin du 19e siècle. Or les seuls éléments authentiques sont des actes de décès, avec la mention de l’insoumission. M. Rogers a-t-il soulevé un dossier supplémentaire qui viendrait confirmer les mauvais traitements infligés aux engagés ? Seul un travail d’historien peut désormais compléter la découverte de l’Ilet à Cabris.
L’expertise de ce travail serait plus que nécessaire, mais également plus éloquent que le silence actuel caractérisant cette affaire. Car l’historien absent prendrait alors le risque de laisser parler à sa place des profanes que souvent l’émotion guide. La tradition orale au « pays » de Césaire (voisin de Guadeloupe), possède peu de version de cette histoire récente. Mais aurait-elle été digne de foi ?
Certaines écoles historiques ne sont pas prêtes à les incorporer dans leur recherche de la vérité. Dans le cas de l’Ilet à Cabris, quelle place accorder à ces témoignages ?
Le maire de Terre de Haut, Louis Molinié, très impliqué dans son rôle d’élu de la République a accepté l’installation d’une stèle sur laquelle figurent les noms des « suppliciés » guadeloupéens. Un habitué des questions de la mémoire des Indiens de la Caraïbe, Francis Ponaman, quant à lui, précise que des Indiens condamnés n’ont jamais été exonérés du célèbre bagne de Cayenne (La Guyane). La municipalité consciente de la nécessité d’un travail pédagogique , élabore un dossier afin d’ établir un site de mémoire sur l’Ilet à Cabri.
En raison des règles de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, cette démarche nécessite de la patience. Elle pourrait être accueillie favorablement dans le cadre de l’année Sidambarom, défenseur fougueux de la cause indienne dans la reconnaissance de leur statut de français et des droits afférents.
L’Ilet à Cabris est-il appelé à devenir un haut-lieu de la mémoire indienne en Guadeloupe ? A l’île Maurice, le dépôt d’immigration des Indiens, appelé Aapravasi Ghât, a été classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, et occupe une place importante dans la mémoire nationale mauricienne.
A La Réunion, l’Ilet Cabri possède son jumeau, l’Ilet à Guillaume. Pascale Moignoux a été l’une des premières plumes à évoquer le sîte4. Juché sur les hauteurs de Saint-Denis le chef-lieu, l’Ilet Guillaume recevait des enfants entre 1864 et 1879, que la société rejetait. Coincés pour des menus larcins ou l’absence de parents, ils étaient internés dans cette "maison de redressement".
Tous ne sont pas revenus de l’Ilet. Quelques uns ont laissé leur vie, accidentellement. Géré par les Jésuites, le site ferma définitivement sur ordre de l’Etat. Dans l’ile, l’Ilet à Guillaume, aujourd’hui abandonné n’est pas resté dans la mémoire collective.
S’agissant de l’attachement à la mémoire de l’engagisme indien, la Région Réunion via le service Patrimoine et l’Association de sauvegarde de la mémoire réunionnaise s’est pleinement engagée en prêtant l’exposition « Coromandel , de l’Inde à la Réunion » à nos amis guadeloupéens.
Qu’il s’agisse de Terre de Haut ou de St François, les communes guadeloupéennes ont bien saisi l’appel lancé par des associations réunionnaises dans le but d’échanger dans le domaine culturel, domaine qui pourrait être amené à s’étendre.
Cette rencontre a représenté une réelle ouverture dans les échanges entre insulaires, une occasion de ne pas céder aux contraintes liées à l’éloignement géographique, sur fond de mémoire aux « Insoumis de l’Ilet à Cabris".
L’ilet aurait abrité les forts Napoléon et Joséphine. Un camp pour isoler les malades existait aussi.
Intellectuel originaire de la Guadeloupe, installé à Paris, qui se bat pour la préservation de la mémoire des engagés Indiens.
SIDAMBAROM Henri, connu à travers son "Procès politique", ouvrage ré-édité à l’occasion de l’anniversaire de sa naissance. Au niveau associatif, l’année Sidambarom 2013, est notamment portée par le petit-fils de celui-ci, Jacques Sidambarom et Jean Samuel Sahai.
MOIGNOUX P. "Graines de bagnard". Roman d’une enfance sacrifiée à l’Ilette à Guillaume. Azalées Editions, 2006